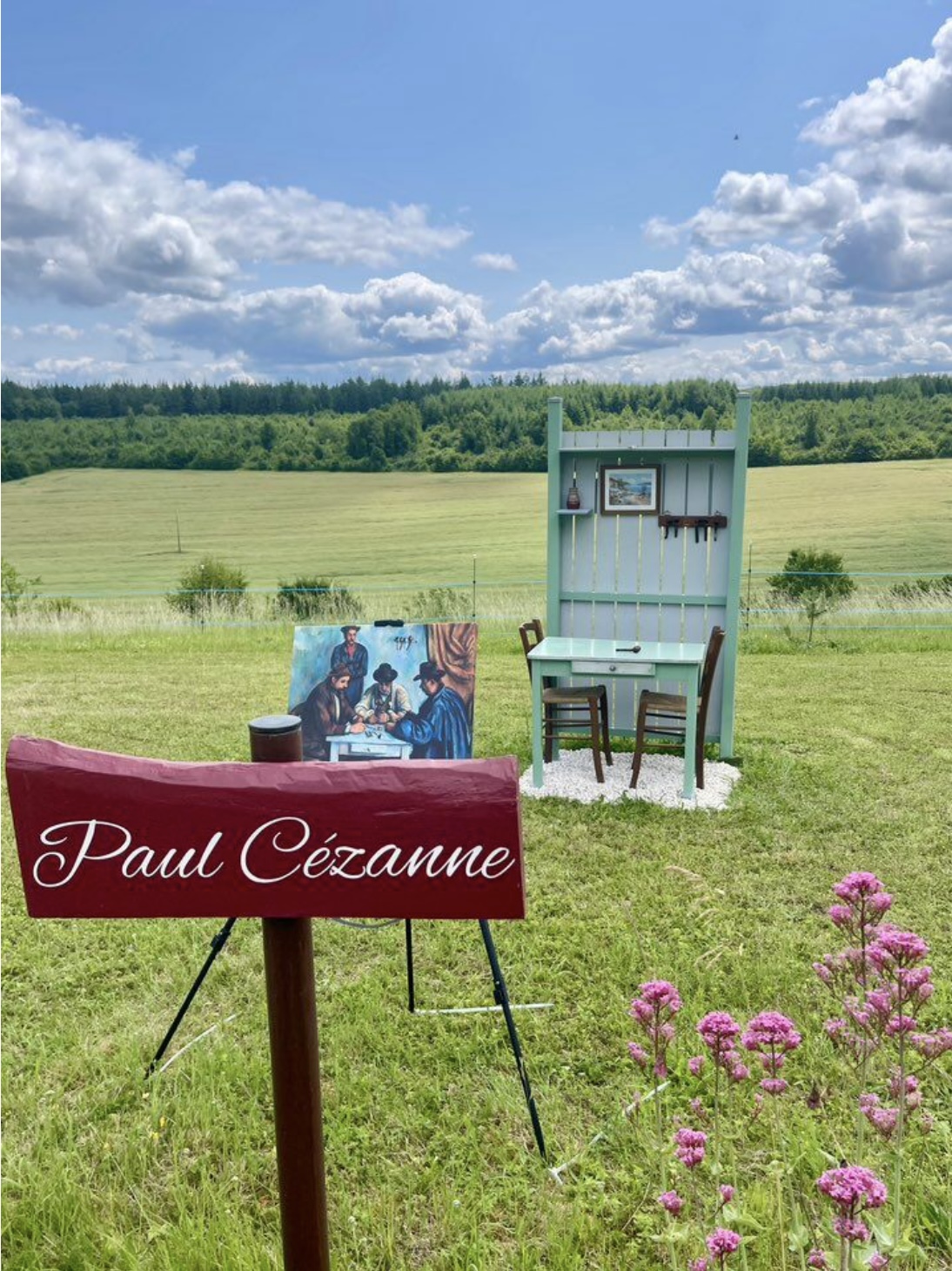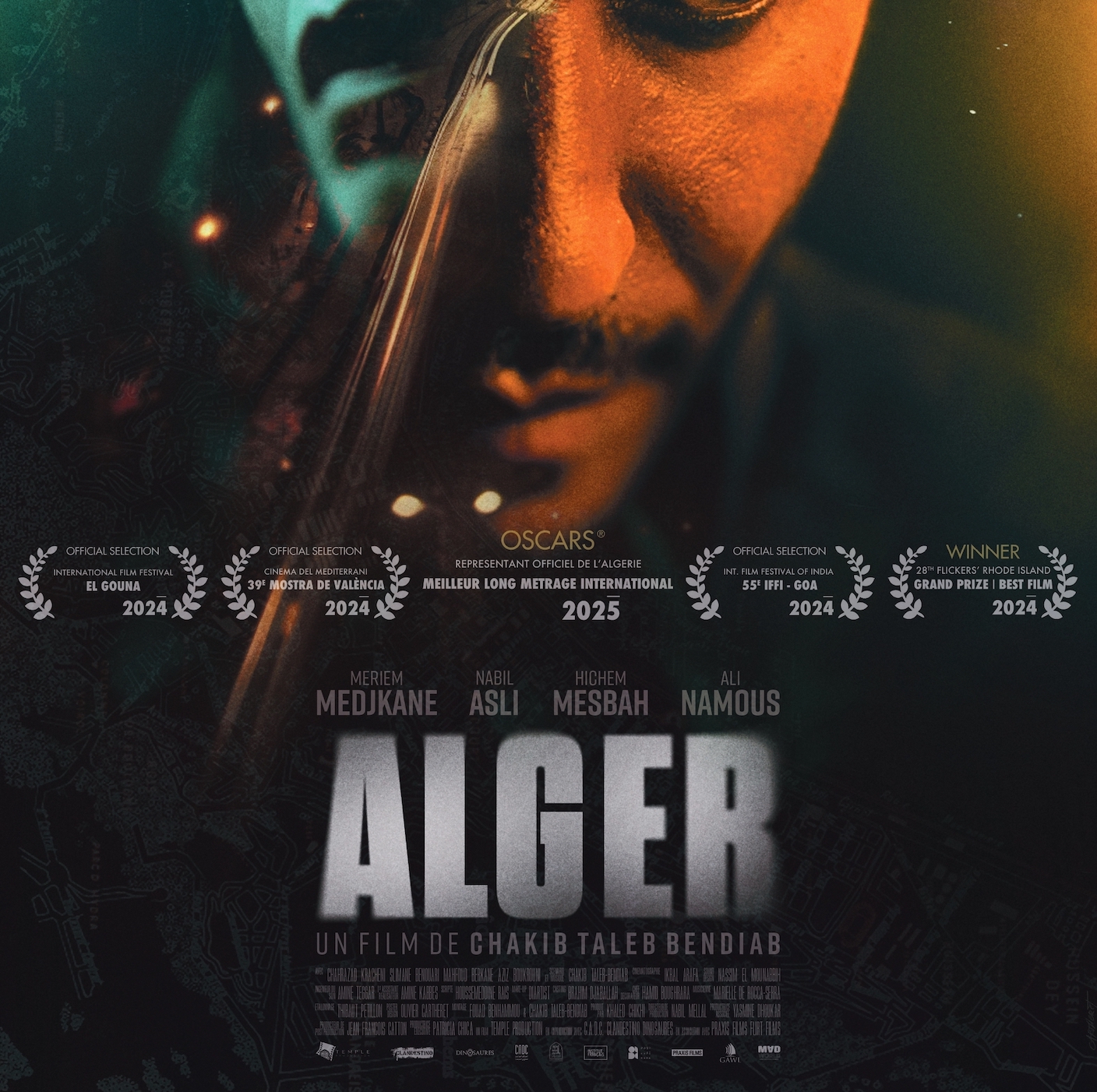À Bobigny, une figure emblématique de la résistance algérienne prend enfin sa place dans l’espace public. Danièle-Djamila Amrane-Minne, militante du FLN, poétesse et historienne, voit son nom donné à une maison de parc départemental, un hommage fort à son engagement pour la libération de l’Algérie et à la mémoire des femmes combattantes. Ce samedi 5 juillet, jour de l’indépendance algérienne, son héritage est célébré bien au-delà des frontières.
Cette initiative s’inscrit dans la politique de féminisation de l’espace public menée par le Département de Seine-Saint-Denis, qui entend mettre en lumière des figures féminines ayant marqué l’histoire. En présence de plusieurs membres de sa famille, de Stéphane Troussel, président du Département, et d’élus locaux, cette cérémonie est aussi l’occasion de rappeler le rôle fondamental des femmes dans les luttes de libération.
Une jeunesse engagée dans la lutte algérienne
Née en 1939 à Neuilly-sur-Seine, Danièle Amrane-Minne rejoint l’Algérie avec ses parents en 1948. Elle est la fille de Pierre Minne, ancien résistant, et de Jacqueline Netter, également résistante, qui deviendra l'épouse du militant communiste Abdelkader Guerroudj. En 1957, ce dernier est condamné à mort avec Jacqueline Guerroudj pour complicité avec Fernand Iveton. L’affaire suscite une vaste mobilisation en France, notamment menée par Simone de Beauvoir. Aucun des deux ne sera exécuté.

Danièle, qui a pris le nom de Djamila dans la clandestinité, rejoint le FLN à seulement 16 ans. Elle participe à un attentat à Alger, puis rejoint le maquis avant d’être arrêtée. Condamnée à sept ans de prison en 1957, elle y écrit deux recueils de poèmes, Histoire d’une jeune fille au temps de la guerre et Poèmes pour l’Algérie, dont l’un sera primé par Jeune Afrique à l’indépendance.

Une mémoire féminine au cœur de l’histoire
Devenue universitaire, première historienne diplômée de l’Algérie indépendante, elle consacre sa carrière à la mémoire des femmes combattantes. Dans les années 1980, elle recueille les témoignages de 88 moudjahidate et signe une thèse magistrale : Les femmes algériennes dans la guerre de libération nationale (1954-1962). Publié en 1991, l’ouvrage fait date et devient une référence incontournable sur la place des femmes dans l’histoire algérienne.
Installée en France dans les années 1990, elle enseigne à Toulouse et poursuit ses recherches sur les femmes, la mémoire et les luttes anticoloniales. Elle meurt en 2017 à Alger.
En lui dédiant cette maison de parc, la Seine-Saint-Denis rend hommage à une figure longtemps restée dans l’ombre en France, où les parcours de femmes engagées dans la lutte de libération algérienne sont encore trop peu reconnus. Une femme dont les engagements ont tracé des ponts entre histoire, poésie, féminisme et décolonisation.