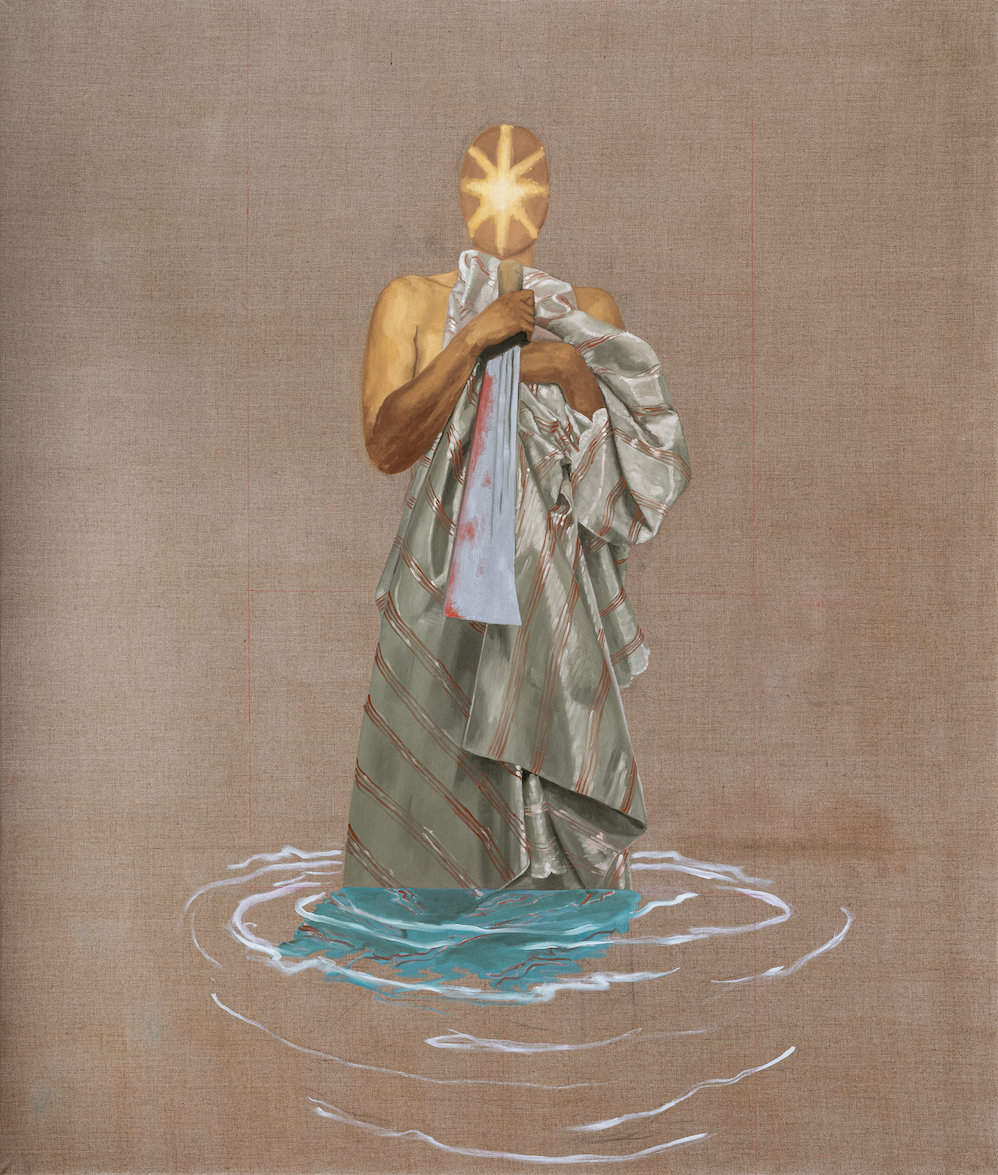Lauréat du Prix littéraire 2025 de la Grande Mosquée de Paris dans la catégorie Essai, l’économiste El Mouhoub Mouhoud signe avec Le Prénom : auto-histoire de l’immigration algérienne une auto-histoire à la fois intime et collective. Entre souvenirs familiaux et réflexion sur la mémoire de l’immigration, l’auteur tisse un récit de transmission et de réparation.
Un prix, une mémoire
Le 9 octobre 2025, la Grande Mosquée de Paris a célébré la quatrième édition de son Prix littéraire, qui distingue les ouvrages mettant en lumière les cultures et les mémoires issues du monde musulman.
Dans la catégorie Essai, c’est Mouhoub El Mouhoud qui a été récompensé pour son œuvre, paru le 19 septembre.
L’annonce, confie-t-il, fut une surprise :
« Le livre venait à peine de sortir. Ce prix, je le reçois avec une grande joie, surtout pour la mémoire de mon père, disparu il y a un an. Il aurait aimé être là. »
Un prénom comme fil d’histoire
Le Prénom s’ouvre sur un double récit : celui d’une vie et celui d’une génération.
De la Kabylie des années 1960 à la France des années 1970, l'économiste retrace sa trajectoire personnelle tout en esquissant ce qu’il appelle une « auto-histoire de l’immigration algérienne ».
« C’est la rencontre entre une destinée individuelle et tout un cortège de gens que je transporte en moi : mes parents, mes aïeux. »
Le titre du livre prend ici une dimension symbolique.
El Mouhoub, explique-t-il, vient du verbe arabe “wahaba”, “donner” : el mouhoub, “celui qui reçoit le don”.
Mais au-delà de l’étymologie, le prénom devient le vecteur d’une mémoire spirituelle.
« En Kabylie, c’était un prénom très courant dans les villages maraboutiques. Les Morabétines étaient parmi les premiers Berbères convertis à l’islam, un islam syncrétique, nourri par le soufisme et adapté aux traditions locales. »
Le nom, l’héritage et la blessure coloniale
L’auteur relie son prénom à son patronyme, Mouhoud, pour interroger le rapport entre identité et colonisation.
« Le patronyme, c’est une invention coloniale. La loi de 1882 a obligé les indigènes à prendre un nom de famille pour les recenser, les contrôler, les isoler. Avant cela, on était fils d’un tel, membre d’un clan, d’une tribu. »
Ce passage, d’apparence administrative, a pourtant bouleversé les structures sociales.
Nommer, c’était fragmenter. Et dans cette fragmentation, El Mouhoub cherche aujourd’hui à retrouver la continuité : celle des filiations, des savoirs et des transmissions que la colonisation avait dispersés.
Réparer plutôt que s’élever
Dans son ouvrage, l’économiste et universitaire aborde la question de l’immigration non pas sous l’angle de la rupture mais de la réparation sociale.
Il rejette les concepts de “transfuge de classe” ou de “promotion individuelle” pour leur préférer celui d’une réparation par le savoir.
« Mes parents étaient visionnaires, intelligents, brillants. S’ils avaient eu accès à l’école comme moi, ils seraient devenus des gens remarquables. L’immigration, pour notre famille, a été une seconde chance. »
Cette phrase résume la philosophie du livre : transformer la trajectoire migratoire en héritage partagé, non en exception.
L’école, dit-il, fut le premier territoire de cette réparation.
« Enfant, il me répétait : “Il faut devenir quelqu’un.” Quand je lui demandais ce que cela voulait dire, il répondait : “Quelqu’un qui étudie, quelqu’un qui transmet.” »
Témoigner contre l’oubli
En recevant ce prix, l’universitaire rappelle que le récit de l’immigration algérienne en France reste incomplet.
Il refuse les simplifications qui réduisent cette histoire à la délinquance, au sport ou à la réussite spectaculaire.
« Les masses de gens issus de l’immigration qui réussissent par l’école sont invisibilisées. Ce livre est aussi une manière de témoigner pour eux. »
Ainsi, son livre n’est pas seulement un texte autobiographique : c’est une archive vivante, un miroir tendu à ceux qui, depuis les villages kabyles jusqu’aux banlieues françaises, ont fait de la connaissance une résistance.
« Le prénom raconte ce que l’histoire a effacé. »
Conclusion
En rendant hommage à ses racines tout en interrogeant l’héritage colonial, l’auteur redonne au mot “origine” son sens premier : celui du commencement, non de l’enfermement.
Son livre, couronné par la Grande Mosquée de Paris, s’inscrit dans une lignée d’écrivains qui refusent l’amnésie et choisissent la transmission.
Et dans cette transmission, son prénom devient ce qu’il signifie : un don
Économiste reconnu, Mouhoub el Mouhoud est président de l’Université Paris-Dauphine-PSL depuis 2024. Spécialiste des migrations et du développement, il a publié plusieurs travaux sur la mobilité internationale et les enjeux économiques liés à la mondialisation.